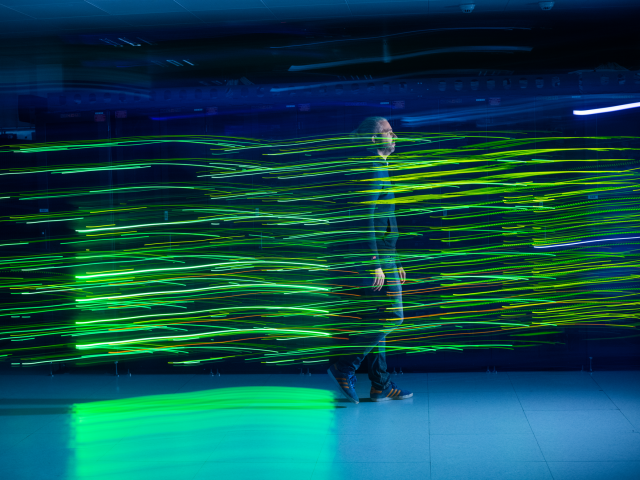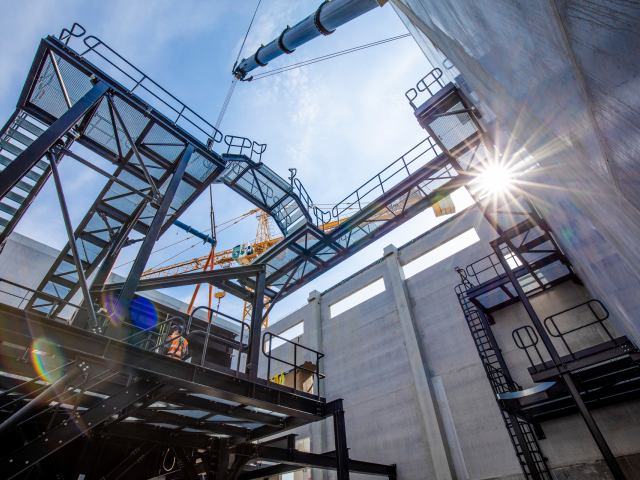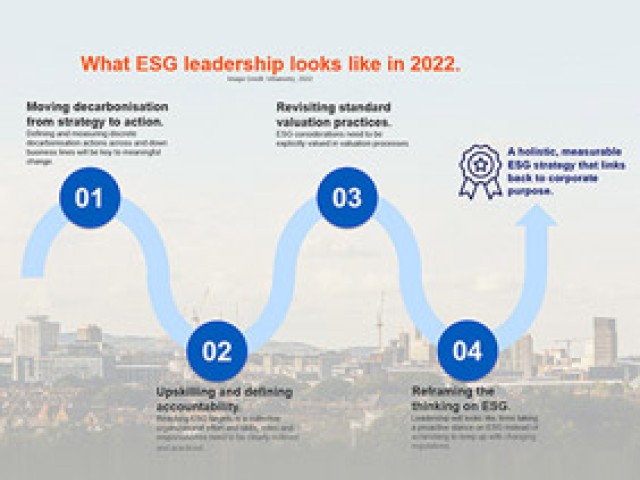Par Félix Briaud
10/11/2025
Temps de lecture : 9 min
Depuis 200 ans, la perte des espèces se produirait à un rythme 10 à 1 000 fois plus rapide que le rythme naturel.
C’est à cette situation alarmante que répondent le règlement européen sur la restauration de la nature et sa déclinaison par les États membres de l’Union européenne, d’ici à septembre 2026, en plans nationaux.
Selon cette page du site de l’Office français de la biodiversité, un "effondrement" de la biodiversité est bien à l’œuvre actuellement, rappelant que celui-ci résulte des activités humaines.
Pourquoi parle-t-on d’ "effondrement" ? Jugez plutôt :
- 68% des populations de vertébrés (mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens) ont disparu entre 1970 et 2016
- 40% des insectes sont en déclin au niveau mondial. La masse de ces insectes diminue de 2,5% par an depuis 30 ans, alors que 75% des cultures alimentaires en Europe dépendent des insectes pollinisateurs
- 75% des milieux terrestres sont altérés de façon significative, plus de 85% des zones humides ont été détruites
- 66% des milieux marins sont détériorés
- et 15 milliards d’arbres sont abattus chaque année dans le monde
La liste ne s’arrête pas là, puisque 33% des récifs coralliens sont menacés - ce qui fait écho à cette actualité récente selon laquelle la planète aurait franchi son premier point de bascule, avec le "dépérissement généralisé" des récifs coralliens d’eau chaude, selon un rapport publié par 160 scientifiques issus de 23 pays.
Un singe Tamarin Lion, objet d'un programme de protection d'EDF en partenariat avec l'association Mico Leao Dourado, au sein de la réserve biologique Uniao, au Brésil. Crédit photo : Philippe Eranian / TOMA.

Transcription
Un singe Tamarin Lion, objet d'un programme de protection d'EDF en partenariat avec l'association Mico Leao Dourado, au sein de la réserve biologique Uniao, au Brésil. Crédit photo : Philippe Eranian / TOMA.
Un règlement européen pour restaurer la nature
C’est pour répondre à cette urgence que la Commission européenne a présenté, en 2022, une proposition de règlement relatif à la restauration de la nature. Ce texte est l’un des nombreux projets issus du pacte vert pour l’Europe, qui fixe l’objectif d’atteinte de la neutralité carbone pour le continent à l’horizon 2050.
Le règlement sur la restauration de la nature vise à restaurer au moins 20% des zones terrestres et des zones marines de l’UE d’ici à 2030, et l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés à l’horizon 2050.
Que signifie "restaurer" ? C’est en premier lieu le fait de renforcer les écosystèmes, avec des objectifs chiffrés de surfaces restaurées – qu'il s'agisse des oiseaux, des habitats, de la faune ou de la flore. La deuxième cible de ce règlement concerne l’augmentation de la biodiversité dans différents écosystèmes à travers des indicateurs de biodiversité et des objectifs qui doivent être définis.
Il est tout autant question ici d’écosystèmes terrestres, détaille le règlement, que d’environnements côtiers, forestiers, agricoles et urbains, sans oublier les écosystèmes marins - jusqu’aux prairies sous-marines et aux bancs d’éponge ou de corail.
Le déclin des insectes pollinisateurs doit également avoir été inversé d’ici à 2030. Notons qu’une étude, menée par des chercheurs allemands et français et financée par l’UE, a évalué à 153 milliards d’euros par an les services rendus par ces insectes ; c’est presque 10% de la valeur totale de la production agricole mondiale.
Forêt de bouleaux en hiver à Marmande, dans le Lot et Garonne. Crédit photo : Bruno Conty / EDF.

Transcription
Forêt de bouleaux en hiver à Marmande, dans le Lot et Garonne.
Crédit photo : Bruno Conty / EDF.
Crédit photo : Bruno Conty / EDF.
Trois milliards d’arbres supplémentaires doivent également avoir été plantés à cette même échéance de 2030. Il est spécifié, enfin, que les sites Natura 2000 se verront accorder la priorité par les États membres lors de la mise en œuvre des mesures de restauration.
Cependant, c’est l’indispensable articulation entre une planification et la prise de conscience de tout un chacun qui nous permettra de restaurer les habitats naturels, les habitats des espèces et les habitats marins : c’est par exemple le choix de créer une haie ; de ne pas artificialiser (c’est-à-dire bétonner) un champ ou une zone agricole ; de ne pas pulvériser de pesticides ; ou encore l’installation de nichoirs avec de la nourriture et un point d’eau, particulièrement en hiver.
Décliner le règlement européen à l’échelle des États membres, avec les plans nationaux de restauration de la nature
Voté par le Parlement européen puis adopté par le Conseil de l’Union en 2024, la suite du processus législatif veut justement que les 27 États membres se saisissent du règlement. Chacun d’entre eux dispose d’un peu plus de deux ans pour établir un plan national de restauration de la nature. Ces différents plans nationaux doivent être présentés à la Commission européenne en septembre 2026.
La France étant le 6ème pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées selon la liste rouge de l’UICN, l’Union internationale pour la conservation de la nature, son plan national de restauration de la nature sera donc scruté de près.
S’appuyant sur une base scientifique solide et des critères précis pour évaluer le risque d’extinction des différentes espèces, cette liste rouge de l’UICN est l’inventaire mondial le plus complet de l’état de conservation global des espèces végétales ou animales.
Paysage de la Baie de Somme, vue du Crotoy (Somme), zone humide couverte par des mesures de protection telles que le réseau Natura 2000. Crédit photo : Philippe Eranian / TOMA.

Transcription
Paysage de la Baie de Somme, vue du Crotoy (Somme), zone humide couverte par des mesures de protection telles que le réseau Natura 2000. Crédit photo : Philippe Eranian / TOMA.
En France, une concertation préalable s’est achevée à la fin du mois d’août, à laquelle des entreprises comme EDF, le Groupe SNCF, Castorama France ou encore notre client HAROPA Port ont contribué par le biais de "cahiers d’acteurs".
En préambule de son cahier d’acteur, EDF explique par exemple que "s’engager dans la restauration de la nature est un investissement nécessaire pour les territoires, leurs habitants et les entreprises qui y sont implantées".
EDF formule ensuite trois axes de réflexion pour l’élaboration du plan français pour la restauration de la nature :
- Pourquoi restaurer, où l’énergéticien avance que notre ambition collective doit être à la hauteur de l’incertitude de notre avenir climatique, et rappelle que le changement climatique accélère la dégradation des écosystèmes et l’érosion de la biodiversité
- Où restaurer, en proposant de donner la priorité à des zones qui bénéficieront à la fois à la biodiversité, à la préservation du cycle de l’eau et à la séquestration du carbone (forêts, haies, zones humides, ripisylves…), dans le but de consolider la « trame verte et bleue » des territoires
- Comment restaurer, c’est-à-dire utiliser les meilleurs leviers pour y parvenir, que ce soit par la planification territoriale, l’implication du plus grand nombre, l’incitation plutôt que la contrainte à des fins d’acceptabilité des mesures, la gouvernance territoriale ou encore le renforcement de la recherche sur ces sujets afin de pouvoir notamment évaluer les gains des actions de restauration
En parlant de territoires et d’implication du plus grand nombre, mentionnons d’ailleurs que des collectivités, des fédérations et des ONG comme France Nature Environnement, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la FNSEA, le MEDEF, la Ville et la métropole de Montpellier, la Ville de Paris, la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels, celle des Travaux Publics, l’Union Nationale des Entreprises du Paysage ou encore The Shift Project et WWF France se sont également saisies du sujet.
Cette phase de concertation préalable étant désormais achevée, une participation du grand public est prévue au printemps 2026 pour formuler des observations sur le plan rédigé. Sa synthèse est accessible juste ici.
Puis viendra le moment de la présentation du plan national français de restauration de la nature, des commentaires de la Commission européenne et de leur prise en compte.
L’adoption formelle doit quant à elle intervenir en août 2027, avec une révision du plan prévue à ce stade en 2032 et en 2042, ainsi qu’un suivi de sa mise en œuvre tous les six ans.
Drapeaux de l'Union européenne autour du bâtiment de la Commission européenne, à Bruxelles. Crédit photo : Bruno Conty / EDF.

Transcription
Drapeaux de l'Union européenne autour du bâtiment de la Commission européenne, à Bruxelles. Crédit photo : Bruno Conty / EDF.
Au-delà des normes, une indispensable attention et une bonne information de chacun au quotidien
Ce plan national de restauration est une chose mais il n’en reste pas moins important que nous pouvons toutes et tous, avant ces échéances à 2026, 2027 ou 2032, veiller à nos impacts sur la nature et la biodiversité.
Alors qu’une septième limite planétaire, celle de l’acidification des océans, aurait été franchie en septembre 2025, nous devons avoir à l’esprit que l’eau, les animaux et la forêt — sans oublier bien sûr les fossiles, comme le charbon, le gaz et le pétrole — ne sont pas des ressources naturelles inépuisables.
Cette crise de la biodiversité ressemble parfois à s’y méprendre à cette expression populaire qui veut que l’ "on se tire une balle dans le pied" : nous avons évoqué plus haut la situation des insectes pollinisateurs mais nous pourrions également parler du sort réservé aux chauves-souris.
Dans les deux cas, des espèces ayant souvent mauvaise presse. Elles peuvent nous incommoder ou nous faire peur.
Précisons d’abord que, si elles peuvent être porteuses de virus dangereux, aucune chauve-souris en France ou en Europe ne se nourrit de sang humain - contrairement à une croyance populaire.
Les chauves-souris - qui représentent un quart de tous les mammifères, comme nous le rappelle cet article du "Monde" - sont en réalité de solides alliées de l’Homme et de l’agriculture : elles se nourrissent de moustiques, de papillons de nuit, de mouches et autres insectes ravageurs, participant ainsi très activement à la régulation de ces populations.
Chauve-souris frugivore. Crédit photo : Kris Dhondt / Pixabay.

Transcription
Chauve-souris frugivore. Crédit photo : Kris Dhondt / Pixabay.
Malgré leur grande utilité, entre 2006 et 2016 près de 40% des chauves-souris ont disparu en France. La destruction de leurs habitats et de haies, où elles peuvent chasser ; l'intensification des pratiques agricoles et l'épandage de pesticides, notamment les néonicotinoïdes ; sans oublier le changement climatique et les variations de températures qui les rendent vulnérables : de nombreuses causes sont à l'œuvre.
Une étude parue dans la revue Science a même établi que l’utilisation accrue d’insecticides - pour compenser, précisément, la perte de populations de chauves-souris insectivores - a causé une surmortalité de 1 300 nouveau-nés, entre 2006 et 2017, dans les 245 comtés américains étudiés (8% des comtés américains). Tout en évaluant les pertes de revenus et de production agricoles à près de 2,7 milliards de dollars par an (environ 2,3 milliards d’euros, au cours actuel).
Une sixième extinction de masse ?
Avec de tels chiffres à l’esprit, faut-il alors parler de sixième extinction de masse ?
Cette formulation, vieille de plus de 30 ans et questionnée encore récemment par cet article d’avril 2025 publié dans la revue "Trends in Ecology&Evolution", fait écho à la précédente extinction de masse, qui est aussi la plus célèbre.
Il y a 66 millions d’années se produisait en effet celle dite du "Crétacé-Paléogène". Se déroulant probablement sur des milliers d’années (les données fossiles sont très partielles, ce qui complique l’estimation), elle fait suite à la chute d’un astéroïde puis d’une énorme activité volcanique.
La cinquième extinction de masse, provoquée par une hausse des niveaux de dioxyde de carbone et de soufre - et donc un réchauffement brutal de la Terre (à une échelle de temps géologique, s’entend) ainsi qu’une acidification de ses océans - emporta avec elle 75% des espèces.
Détail d'un squelette de dinosaure au musée d'histoire naturelle de Londres. Crédit photo : OltreCreativeAgency / Pixabay.

Transcription
Détail d'un squelette de dinosaure au musée d'histoire naturelle de Londres. Crédit photo : OltreCreativeAgency / Pixabay.
Si cet épisode est si célèbre, c’est que parmi les espèces rayées de la carte figurent les dinosaures non-aviens, c’est-à-dire tous les dinosaures, à l’exception des oiseaux.
66 millions d’années plus tard, et sixième extinction de masse ou pas, cela ne doit pas détourner notre regard du fait que l’humanité est bel et bien entrée dans une période de crise de la biodiversité : si les activités humaines devaient se poursuivre au rythme actuel — et tout en restant prudent sur cette lecture, qui ne fait donc pas consensus parmi les scientifiques — 75% des espèces pourraient de nouveau disparaître de la surface de la Terre d'ici à 300 ans.

Transcription
Photo de Félix Briaud, responsable communication & RSE d'Urbanomy. Urbanomy est un cabinet de conseil stratégique énergie et climat, filiale du groupe EDF.
L'auteur
Félix Briaud
Félix est le responsable communication & RSE d’Urbanomy.
Journaliste durant dix ans, il a ensuite bifurqué vers la data appliquée à la publicité digitale. Ce n’est que récemment qu’il s’est convaincu, en rejoignant le cabinet, de mettre en adéquation sa vie professionnelle avec ses convictions personnelles au sujet de l'environnement.
En dehors de cela, Félix est fou de musique - particulièrement de la période allant des années 1950 aux années 1970. Dans ce domaine comme dans d’autres, il regorge d'anecdotes et sera sans aucun doute ravi de vous en raconter une ou deux.
Ces articles pourraient vous intéresser
Newsletter
Loi Duplomb, prolongation de PACTE Industrie, logements bouilloires : actualités été 2025

Nos accompagnements
Décarboner votre portefeuille immobilier : cadre, méthode et retour d'expérience